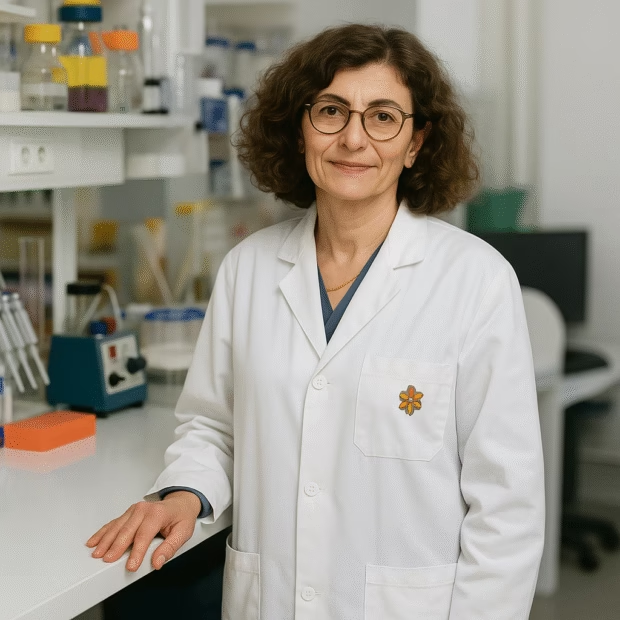En France, en Italie ou en Allemagne, de nombreuses femmes réfugiées passent de l’exil à l’engagement, malgré des parcours semés d’obstacles.
Longtemps cantonnées aux marges des récits migratoires, les femmes migrantes sont souvent perçues comme des figures passives de la migration : victimes de guerre, de violences, ou dépendantes des hommes. Pourtant, sur le terrain, de nombreuses réfugiées prennent la parole, créent des associations, s’engagent politiquement ou socialement dans leurs pays d’accueil. De Paris à Palerme, en passant par Berlin, elles sont invisibles pour beaucoup, mais essentielles à la reconstruction du tissu social.
Invisibles malgré leur présence
Selon le rapport Eurostat 2024, près de 42 % des demandes d’asile en Europe sont déposées par des femmes. Pourtant, peu de politiques migratoires tiennent compte de leur parcours spécifique, marqué par des violences sexuelles, des responsabilités familiales ou des obstacles linguistiques et administratifs.
➡️ En Italie, nombre de femmes migrantes restent confinées à des rôles domestiques ou informels, sans accès aux droits.
➡️ En France, les centres d’hébergement mixtes ne garantissent souvent pas la sécurité des femmes victimes de violences.
➡️ En Allemagne, la complexité des démarches administratives freine leur accès à la santé mentale ou à la formation professionnelle.
De l’exil à l’engagement
A. France – Aïssata, du centre d’hébergement au collectif féministe
Arrivée de Guinée en 2018, Aïssata a fui un mariage forcé. Hébergée dans un foyer parisien, elle découvre l’association Voix des Femmes Sans-Papiers. Aujourd’hui, elle coanime des ateliers juridiques pour aider d’autres femmes à faire valoir leurs droits.
« Prendre la parole m’a rendue forte. Maintenant, je veux transmettre cette force aux autres. »
B. Italie – Saba, une radio pour briser le silence
Érythréenne, arrivée à Palerme après avoir traversé la Libye, Saba crée une web-radio, MigrantiVoices, animée par des femmes réfugiées en tigrinya, arabe et italien.
« On parle de santé, de cuisine, d’amour, mais aussi de papiers, de racisme et de survie. »
C. Allemagne – Amal, médiatrice interculturelle à Berlin
Après avoir fui la Syrie avec ses enfants, Amal s’est formée comme interprète et travaille aujourd’hui dans des structures d’accueil. Elle facilite les dialogues entre femmes réfugiées et travailleurs sociaux.
« Mon rôle, c’est de traduire les mots, mais aussi les peurs et les espoirs. »
Ce que leur engagement révèle
Ces trajectoires montrent que les femmes migrantes ne sont pas seulement en quête de protection : elles construisent des espaces de solidarité, d’apprentissage et d’émancipation.
Trois constantes ressortent :
-
La création de réseaux communautaires féminins
-
L’usage de la parole (ateliers, médias, formations) comme outil d’autonomie
-
Une exigence de reconnaissance politique et citoyenne, souvent ignorée par les politiques publiques
Une résistance silencieuse mais puissante
Malgré les entraves, ces femmes bâtissent des ponts entre cultures, entre quartiers, entre générations. Elles refusent d’être assignées à la case de “victime” et réclament le droit d’exister pleinement.
« Je suis migrante, femme, noire et musulmane. Mais je suis aussi éducatrice, poétesse et citoyenne de ce pays. »
— Samira, originaire du Soudan, militante à Marseille
Reconnaître, soutenir, valoriser
Les femmes migrantes réinventent les formes de résistance dans l’Europe contemporaine. Soutenir leur action, c’est renforcer la cohésion sociale et briser les stéréotypes. C’est aussi faire un pas vers une politique migratoire plus inclusive, genrée et juste.
![]()