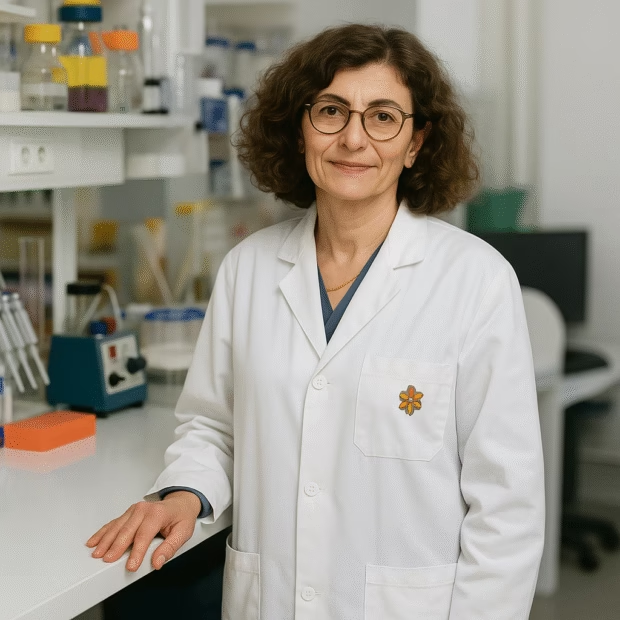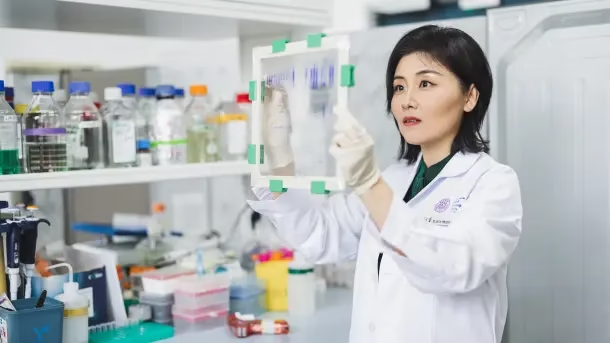Parmi les mutations profondes de l’Australie contemporaine, une révolution discrète mais déterminée est en marche : celle des femmes autochtones qui, entre résilience culturelle et combat juridique, s’imposent peu à peu sur la scène publique.
Longtemps reléguées aux marges du débat politique, les femmes aborigènes australiennes font aujourd’hui entendre leur voix avec une force nouvelle. Que ce soit à la tribune du Parlement, dans les salles de rédaction ou au cœur des créations culturelles, elles portent avec fierté la mémoire de leurs ancêtres tout en s’attaquant aux injustices persistantes du système australien.
Du silence à la parole politique
Il aura fallu attendre 2001 pour qu’une première femme aborigène, Carol Martin, soit élue dans un Parlement australien. Depuis, les figures féminines se multiplient, à l’image de Linda Burney, aujourd’hui ministre des Affaires autochtones. Elle a été la première femme aborigène élue à la Chambre des représentants et incarne une nouvelle génération de femmes politiques issues des Premiers Peuples.
À ses côtés, des voix comme Lidia Thorpe (sénatrice du Victoria) ou Dorinda Cox (sénatrice de l’Australie-Occidentale) bousculent l’ordre établi. Leurs discours, souvent incisifs, dénoncent le racisme structurel et appellent à une refondation démocratique fondée sur la reconnaissance des peuples autochtones comme premiers habitants et gardiens de la terre australienne.
L’échec du référendum, mais pas du combat
En 2023, la proposition de créer une “Voice to Parliament”, un organe consultatif pour les peuples autochtones inscrit dans la Constitution, a été rejetée par référendum. Ce revers a marqué une désillusion pour de nombreuses communautés, mais a aussi renforcé l’engagement des militantes.
« Ce n’est pas une défaite, c’est un nouveau départ », a affirmé Lidia Thorpe à l’issue du scrutin. Pour elle comme pour d’autres, le combat continue, sur le terrain, dans les institutions, et dans les consciences.
Porte-voix culturels et médiatiques
La lutte ne se joue pas uniquement dans l’arène politique. Les femmes autochtones investissent massivement les sphères culturelles et médiatiques. Juriste, écrivaine et documentariste, Larissa Behrendt milite pour les droits des peuples autochtones à travers ses ouvrages et ses films, tout en dirigeant le Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research à l’Université de technologie de Sydney.
Dans le monde de l’art, des musiciennes comme les Tiddas, des réalisatrices comme Rachel Perkins, et de nombreuses conteuses, peintres ou chorégraphes perpétuent et réinventent les traditions culturelles de leurs communautés.
Une renaissance culturelle au féminin
Au-delà des discours et des revendications juridiques, un profond mouvement de renaissance culturelle traverse les communautés aborigènes, porté par les femmes. Dans les écoles communautaires, on enseigne de nouveau les langues indigènes. Des festivals célèbrent les danses et les chants traditionnels. Et les batailles pour la préservation des sites sacrés se multiplient.
« Nos histoires, nos chants, notre terre : tout cela est politique », confie Marcia Langton, universitaire et militante de longue date. Pour elle, la résistance passe aussi par la transmission : « Si nous perdons nos langues, nous perdons notre pouvoir. »
Un nouvel horizon
De la scène parlementaire aux cercles d’art et d’éducation, les femmes autochtones australiennes incarnent aujourd’hui un souffle nouveau. Leur ascension symbolise une double victoire : celle de la reconnaissance d’un héritage millénaire et celle de l’affirmation d’un avenir où justice, équité et respect des cultures autochtones peuvent coexister avec les défis du monde moderne.
Et si c’était là le visage de la démocratie réparatrice ?
![]()